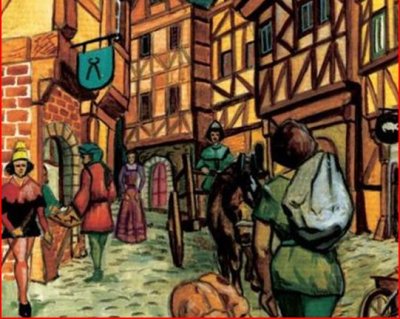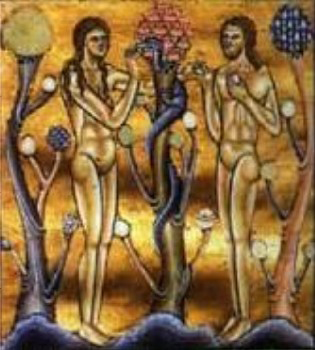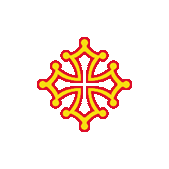|
Les deux traités
authentiques
Le Livre des
deux principes et le Traité Cathare anonyme

|
Le "Livre de deux
principes" (Liber de duobus principiis) est parvenu
jusqu'à nous dans un
seul manuscrit daté de la fin du 13e siècle. Il a probablement été
écrit par Jean de Luigo de Bergame, vicaire de l'évêque cathare
des Albanenses de Desenzano (dualistes absolus). Conservé à
la Bibliothèque nationale de Florence, il a été publié en 1939 par
le Père Dondaine. C'est le seul exposé théologique authentiquement cathare
qui a été retrouvé. Il contient des fragments, des résumés et des
développements polémiques que j'exposerai dans l'ordre du
manuscrit. L'ouvrage comprend sept traités intitulés : De
liberio arbitrio, de creatione, de signis universalibus,
compendium ad intructionem rudium, contra Garatenses, de arbitrio,
de persecutionibus. Les trois premiers, (du libre arbitre, de
la création, et des signes universels) constituent la controverse
sur les deux principes. Le Compendium, (Abrégé pour
l'instruction des ignorants), expose brièvement la portée de
la doctrine des deux principes sur la Création. Le Traité contre
les Garatenses, contra Garatenses, réunit quelques
fragments dévoilant les divergences doctrinales entre les deux
courants cathares (dualistes absolus et relatifs). Le court
traité de arbitrio reprend le thème des deux principes dans
des fragments disparates, et le recueil de persecutionibus
rassemble diverses citations préparant les fidèles cathares aux
persécutions qui les attendent. |
|
 |
|
Le premier traité expose qu'il
n'y a pas de "libre arbitre" dans l'Homme.
L'auteur réfute plusieurs propositions imputées à des adversaires
supposés. Un être, quel soit-il, dit-il, est né pour le Bien,
ou pour le Mal. Si un homme n'a pas été fondé pour le Bien, n'en ayant
donc pas la volonté et n'étant pas capable de le distinguer du
Mal, il n'a pas la capacité de faire son salut. Car, si un
être pouvait faire autre chose que le fruit de son essence, rien
n'empêcherait que le Diable ne devint Christ et le Christ, Satan,
l'impossible devenant possible. Si l'Homme peut faire le Mal,
c'est qu'il fut, à l'origine, voulu et pensé par le Dieu
bon, tout puissant et omniscient, comme capable de
le faire, tout au moins dans le temps. Et donc,
(du moins pour les Albanenses), le Mal n'est qu'une épreuve
temporaire, tolérée par ce Dieu bon. Elle est
temporellement vécue dans la succession des incarnations, mais
elle épuise, progressivement et par elle-même, son contenu dans
l'éternité, et finalement tous les anges perdus reviendront en Dieu. Puisque le Dieu bon ne
peut être la cause ni le principe de tout mal, il faut
reconnaître l'existence de deux principes, celui du Bien et celui
du Mal. Toutes les actions individuelles sont inspirées
par l'un de ces principes, du Bien ou du Mal. Seul le
vrai Dieu peut sauver les âmes qui ne sont, en
elles-mêmes, ni responsables, ni punies, ni récompensées. Et l'âme
qui est sauvée l'a toujours été. |
|
 |
|
Le traité suivant se
propose également de réfuter d'éventuelles propositions
adverses. Il s'agit des différentes acceptions possibles des
mentions scripturaires de l'acte de Création. Pour l'auteur,
ces mentions n'ont jamais le sens d'une création à partir du
néant. Elles impliquent toujours la transformation
d'essences préexistantes, toutes issues du vrai Dieu, lequel
a créé et fait l'univers entier, en lui et de sa propre
substance. "Créer" ou "Faire" ont donc trois acceptions dont
le premier genre est d'ajouter quelque chose aux essences
d'êtres déjà très bons. Ainsi l'Écriture dit-elle "Dieu
forma l'homme du limon de la Terre, il répandit sur son
visage su souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé".
De même, le second genre est d'ajouter aux essences
d'entités mauvaises, ce qui permet de les améliorer. "Si
quelqu'un est à Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle
créature". Le troisième genre permet à un être
entièrement mauvais, (comme le Démon ou ses ministres),
d'accomplir temporairement ce qu'il désire mais ne saurait
réaliser par ses propres forces. Le vrai Dieu tolère alors
un temps cette malice. "Sur toutes les nations et sur
tous les hommes, Dieu fait régner l'hypocrite à cause des
péchés du peuple". Par ces trois modes, l'auteur prétend
donc, en définissant le sens qui s'attache dans les
Écritures aux termes universels, montrer que le vrai Dieu a
créé et fait l'univers entier, et qu'il a tout fondé en
Jésus-Christ.
|
 |
|
L'appellation "signes
universels", objets du troisième traité, concerne les
termes généraux qui désignent un ensemble de choses,
(des mots tels que "tout", "toutes choses", ou des expressions
analogues). Dans les Écritures, ces signes ont
plusieurs acceptions. Ils peuvent désigner
l'ensemble des choses ou êtres purs et bons, ou celui des
impurs, pécheurs ou méchants. L'auteur cite les
Écritures pour mettre en garde contre de
possibles confusions. Le quatrième traité, "Abrégé pour servir à
l'instruction des ignorants", condense la doctrine de
Albanenses appuyée sur les Écritures pour la mettre à la portée
des "Croyants". Le vrai Dieu tout puissant ne peut faire le Mal
car il ne le veut pas. Il ne peut pas créer un autre Dieu, et
puisqu'il ne peut faire le Mal, il existe donc une autre
puissance qui est le Mal. Les Écritures disent que Dieu détruira
un jour le Mal pour toujours. Il faut absolument croire
qu'il existe un autre principe très puissant dans le Mal, dont
Sathanas tire sa puissance. Les Écritures disent aussi qu'il
existe d'autres dieux et une éternité mauvaise distincte de
celle du Dieu bon. Le Dieu mauvais est celui qui a fait le Ciel
et la Terre et tout les êtres visibles de ce Monde mais il n'est
pas le véritable Créateur. Et ce mauvais Dieu a ordonné
de prendre par la force le bien d'autrui et de commettre des
homicides. Il a maudit le Christ, n'a pas tenu ses promesses et
s'est laissé voir dans le monde temporel.
|
|
 |
|
Le cinquième traité,
"Contre les Garatenses", présente beaucoup d'intérêt car il
permet d'approcher la principale divergence doctrinale avec
le second courant
cathare, les "dualistes mitigés". L'auteur
combat leur idée qu'il n'existe qu'un seul Créateur très
saint dont le mauvais Prince de ce monde fut d'abord une
créature. Par la suite, celui-ci corrompit les quatre éléments
et en format l'homme et la femme et tous les corps visibles.
S'ils croient, dit-il, qu'il n'y a qu'un seul vrai créateur du
visible comme de l'invisible, ils ne devraient pas rejeter sa
sainte création en condamnant l'œuvre de chair ni en
demeurant végétariens. Ils disent que cette corruption s'est
opérée contre la volonté de Dieu, et ils doivent donc admettre
qu'il existe un autre principe, capable de corrompre les quatre
saints éléments, contre sa volonté ou avec sa permission. Car
ils enseignent aussi que cette permission donnée fut mauvaise et
vaine, et l'on voit qu'elle le fut. Alors, ce Dieu qui aurait
donné cette permission maligne serait lui-même la cause première
du Mal, et ceci est la contradiction de la doctrine des
Garatenses. Le sixième traité revient sur l'affirmation
de l'absence du libre arbitre avec quelques arguments
supplémentaires. Le dernier
traité, "de persecutionibus", prépare les fidèles aux
persécutions attendues en rappelant celles que subirent les
prophètes, le Christ, les apôtres et tous ceux qui les
suivirent. |
|

|
|
Quoique incomplet, le "Traité cathare anonyme" est le second ouvrage
cathare qui nous soit parvenu. Le Père Dondaine en a retrouvé un
court fragment dans le "Liber contra Manichéos" à la
Bibliothèque Nationale. Un fragment plus important se trouve
à la cathédrale de Prague. Il contient
dix-neuf chapitres sur les trente-cinq de l'original. Ces
extraits ont été publiés en 1961 par Christine Thouzellier.
Les citations cathares sont insérées dans une
réfutation prononcée par Durand
de Huesca. On y retrouve la vision cathare du Monde et de la
Création, avec deux "époques", la nôtre tirée du néant,
et qui y retournera, et l'autre peuplée de créatures
incorruptibles et éternelles. Notre monde est tout entier
mauvais. Il ne vient pas du Père ni du Christ. C'est le royaume de Satan. Nous résidons sur une terre
étrangère. C'est dans l'autre royaume que sont le
Ciel nouveau, la Terre nouvelle et la nouvelle Jérusalem.
En s'appuyant sur les textes relatifs à la venue
du Christ, les Cathares, dit l'auteur, en arrivent à poser
deux créations, l'une bonne et l'autre mauvaise. Ce qui est
ici bas n'est rien, "nihil", et ce n'est donc pas
l'œuvre du vrai Dieu. C'est ce que prouverait le prologue de
Jean : "sine ipso factum est nihil", (le rien a été fait
sans lui). La suite du verset, "quod factum est in ipso vita
erat", (ce qui a été fait (les créatures), en Lui
(le Verbe) était vie),
prouve que la bonne création est spirituelle. |

Dualisme
|
|